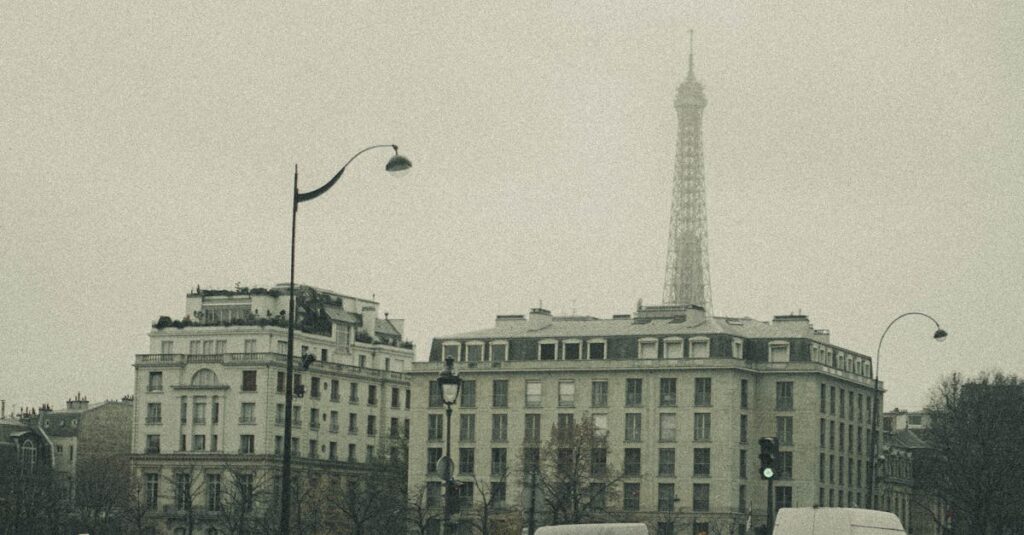
Dans de nombreux pays, la montée en puissance des mouvements populistes de droite menace directement les politiques environnementales, les dépeignant comme des freins au quotidien des citoyens, pour des bénéfices hypothétiques. Ces partis ciblent spécifiquement les citadins aisés, souvent perçus comme donneurs de leçons avec leurs modes de vie « verts », créant un fossé avec les banlieusards et ruraux, dont le sentiment d’humiliation est ainsi instrumentalisé pour rejeter en bloc toute initiative écologique.
Il est indéniable que les classes populaires sont parfois les premières à subir les contraintes de ces politiques. Les autorités ont trop souvent exigé d’elles des efforts disproportionnés, tandis que les plus aisés, pourtant plus grands pollueurs, étaient épargnés. Cette injustice est inacceptable. Cependant, l’amère vérité est que les véritables victimes de la dégradation environnementale ne sont pas les privilégiés, mais bien les plus modestes.
La pollution de l’air en est une illustration frappante. Qui en souffre le plus ? Ceux qui, faute de moyens financiers, sont contraints de vivre à proximité d’installations polluantes ou d’axes routiers majeurs. Les grandes agglomérations comme Paris, Marseille ou Lyon affichent une pollution atmosphérique élevée, masquant des inégalités criantes. En Île-de-France, par exemple, les zones les plus affectées se trouvent massivement en Seine-Saint-Denis, notamment le long de l’autoroute A1, où des dizaines de milliers de personnes subissent un air de mauvaise qualité.
Même les zones rurales ne sont pas épargnées. À l’échelle nationale, les populations des territoires défavorisés respirent un air pollué sept semaines de plus par an que leurs homologues des zones plus riches. Cette réalité démontre un échec flagrant des politiques publiques à protéger équitablement tous les citoyens, transformant l’urgence écologique en un fardeau supplémentaire pour les plus vulnérables.






