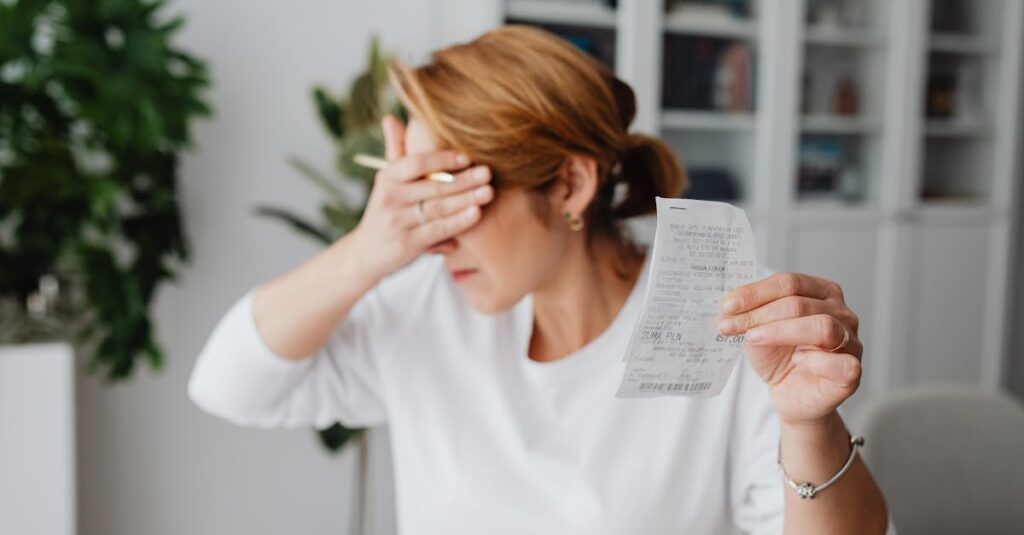
L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » révèle un constat amer : si le dispositif ramène des individus à l’emploi, son coût exorbitant pour l’État soulève de sérieuses questions. Après un examen par la Cour des comptes, le comité scientifique confirme les craintes : l’efficacité a un prix que la collectivité pourrait ne pas supporter.
Ce programme, lancé en 2016 et étendu jusqu’en 2026, vise à réintégrer les chômeurs de longue durée dans des territoires de moins de 10 000 habitants. Des entreprises à but d’emploi sont censées offrir des CDI sans concurrencer les entreprises existantes. Fin 2024, 83 territoires et 86 entreprises employaient 3 290 personnes. Un succès en apparence, mais à quel prix pour les contribuables ?
Le dispositif repose sur l’idée audacieuse que « personne n’est inemployable » et que le coût d’un chômeur est supérieur à celui d’un emploi financé. Cependant, l’étude menée par l’économiste Yannick L’Horty met en lumière des « effets parfois moins désirables, au prix d’un effort public significatif ». En clair, malgré des résultats « globalement remarquables » en matière de réinsertion, l’impact financier négatif sur les finances publiques est jugé trop important.
Alors que le Parlement devra décider d’une éventuelle généralisation en 2026, l’ombre du financement plane. L’État français pourra-t-il réellement assumer un tel fardeau pour maintenir cette initiative, même louable sur le plan humain ? La question demeure, menaçant l’avenir d’un programme jugé trop coûteux.







