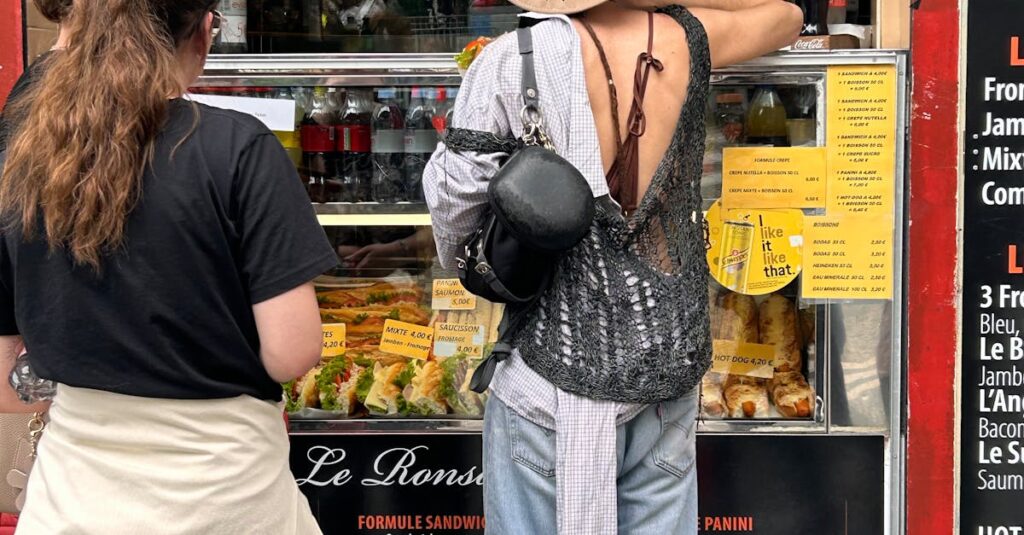
L’ambitieux projet « Territoires zéro chômeur de longue durée », présenté comme une solution miracle, s’enlise déjà. Malgré un soutien politique unanime et des slogans accrocheurs promettant la fin du chômage, la réalité sur le terrain révèle des failles béantes, transformant cette noble intention en une coûteuse désillusion. Ce qui était censé être une révolution de l’emploi se profile comme un simple palliatif, loin de ses promesses initiales.
Lancé en 2016 avec dix territoires pilotes et étendu à 83 zones en 2020, le dispositif repose sur des idées audacieuses : le travail et l’argent ne manquent pas, et personne n’est inemployable. L’objectif était de créer des « entreprises à but d’emploi » (EBE) pour offrir des CDI à temps choisi aux chômeurs de longue durée. Une rhétorique séduisante, notamment le principe d’« activation des dépenses passives » – « Plutôt un salaire que des allocs » – qui a charmé de nombreux élus.
Cependant, les évaluations initiales et les études approfondies des premières années ont mis en lumière des écarts flagrants entre l’ambition utopique et la mise en œuvre concrète. Si quelques effets positifs sont indéniables pour les individus et les dynamiques locales, ils cachent une vérité plus sombre. Le projet peine à définir clairement le rôle et la nature de ces entreprises à but d’emploi, reléguant la question fondamentale du travail au second plan, au profit du simple emploi.
La standardisation progressive de l’expérimentation menace de diluer son caractère innovant, la transformant en une énième politique d’insertion aux résultats mitigés. L’utopie d’un territoire sans chômeur de longue durée se heurte à la complexité du réel, exposant les limites d’une approche qui, malgré ses bonnes intentions, semble incapable de résoudre durablement la problématique du chômage. Le grand rêve social de « Territoires zéro chômeur » risque de finir en cauchemar administratif, engloutissant des ressources sans apporter la véritable transformation espérée.







