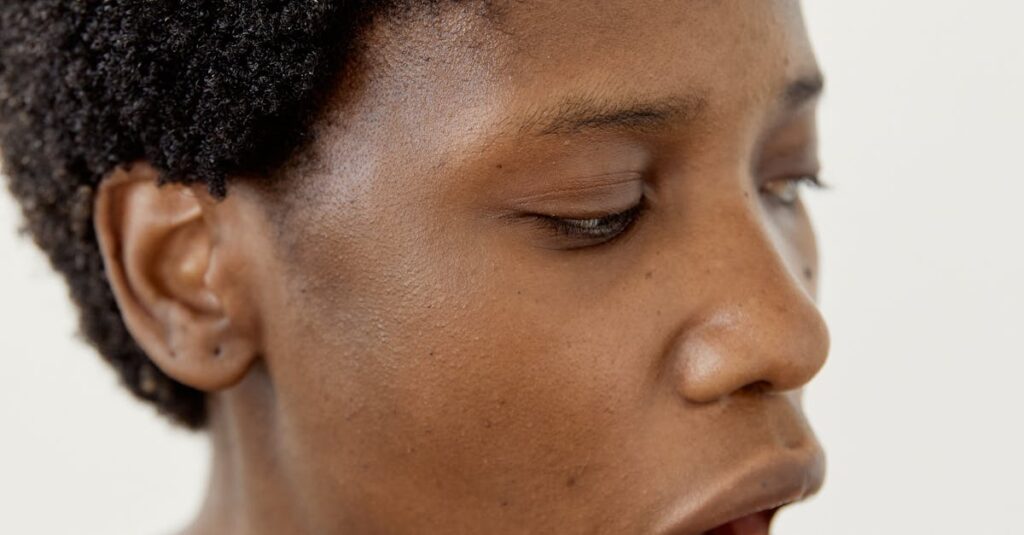
Le système immunitaire, notre bouclier contre les agressions microbiennes, recèle un paradoxe terrifiant : comment nous défend-il sans nous détruire de l’intérieur ? Cette question cruciale, qui hantait les chercheurs et les médecins, a enfin trouvé une réponse glaçante, couronnée par le Prix Nobel de médecine. En effet, Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow et Fred Ramsdell ont été récompensés pour leurs découvertes sur la tolérance immunitaire, un mécanisme complexe et vital.
L’enjeu est colossal : un dysfonctionnement de cette tolérance conduit directement aux maladies auto-immunes, où notre propre corps se retourne contre lui-même. Des affections dévastatrices comme le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux sont les manifestations de cette trahison interne du système immunitaire.
La clé de ce mystère réside dans les lymphocytes T régulateurs (Treg), une troupe d’élite identifiée par Shimon Sakaguchi en 1995. Ces cellules, véritables « freins » du système immunitaire, sont chargées de calmer les réactions excessives et d’empêcher l’attaque des tissus sains. Leur absence ou leur défaillance peut entraîner une perte de contrôle fatale, ouvrant la voie à des pathologies auto-immunes dévastatrices.
Avant cette avancée majeure, les immunologistes savaient que le thymus éliminait une partie des cellules T autoréactives, un processus appelé « tolérance centrale ». Cependant, certains lymphocytes T échappent à ce contrôle, et c’est là qu’intervient la tolérance périphérique, orchestrée par les Treg. La compréhension de ces mécanismes ouvre des perspectives sombres et complexes pour le développement de traitements, soulignant la fragilité de notre propre défense. L’équilibre délicat de notre immunité reste une épée de Damoclès permanente.






