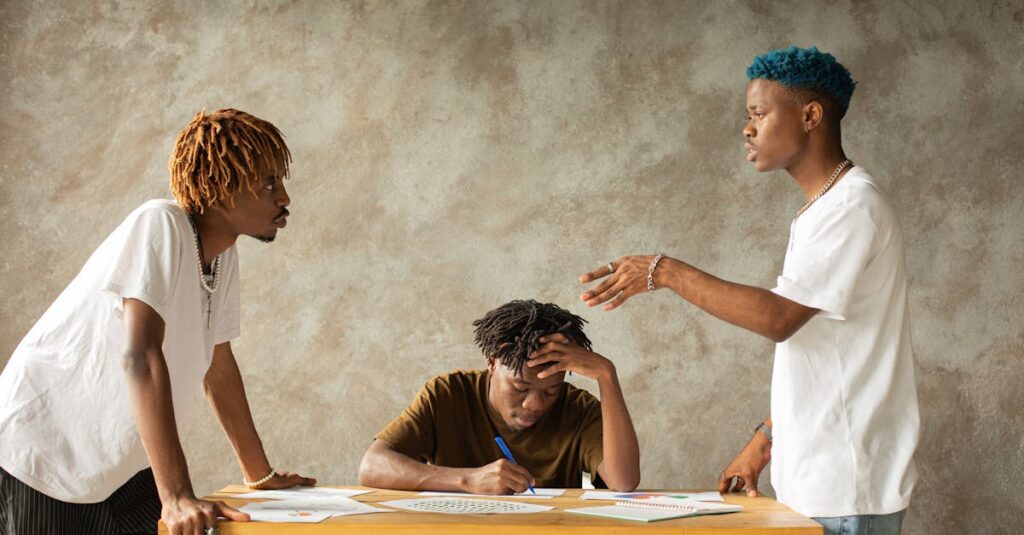
La bande de Gaza est le théâtre d’une trêve précaire, orchestrée par un accord entre Israël et le Hamas, sous l’égide des États-Unis. Si la libération des otages israéliens est annoncée pour bientôt, l’enthousiasme est largement tempéré par les doutes et les avertissements des acteurs régionaux. Le chef de la diplomatie iranienne a déjà exprimé une méfiance profonde envers le « régime sioniste », soulignant les violations passées des cessez-le-feu.
Pendant que les familles des otages retiennent leur souffle à Tel-Aviv, où l’envoyé spécial de Donald Trump a tenté de rassurer une foule sceptique, les voix dissonantes se multiplient. Le Hamas lui-même a déclaré que l’idée d’expulser ses membres de Gaza, inscrite dans le plan de paix américain, est « absurde », promettant une résistance farouche en cas de reprise des hostilités. Cette intransigeance palestinienne risque de rendre la « deuxième phase » des négociations bien plus complexe, voire impossible.
Au même moment, la souffrance psychologique des survivants du massacre du 7 octobre atteint un nouveau paroxysme avec le suicide tragique de Roei Shalev. Un événement qui met en lumière les **lacunes criantes** de l’État d’Israël dans la prise en charge des victimes, transformées en « statistiques » plutôt qu’en héros. Des manifestations pro-palestiniennes se déroulent également en Europe, dénonçant un « génocide » et un « blanchiment des crimes de guerre », même si une nouvelle trêve a été conclue. Les accusations de « sang sur les mains » à l’encontre du premier ministre britannique témoignent d’une polarisation sans précédent. Loin d’une paix véritable, ce cessez-le-feu semble n’être qu’une pause fragile, préfigurant de nouvelles tensions et une incertitude persistante pour une région déjà dévastée.






