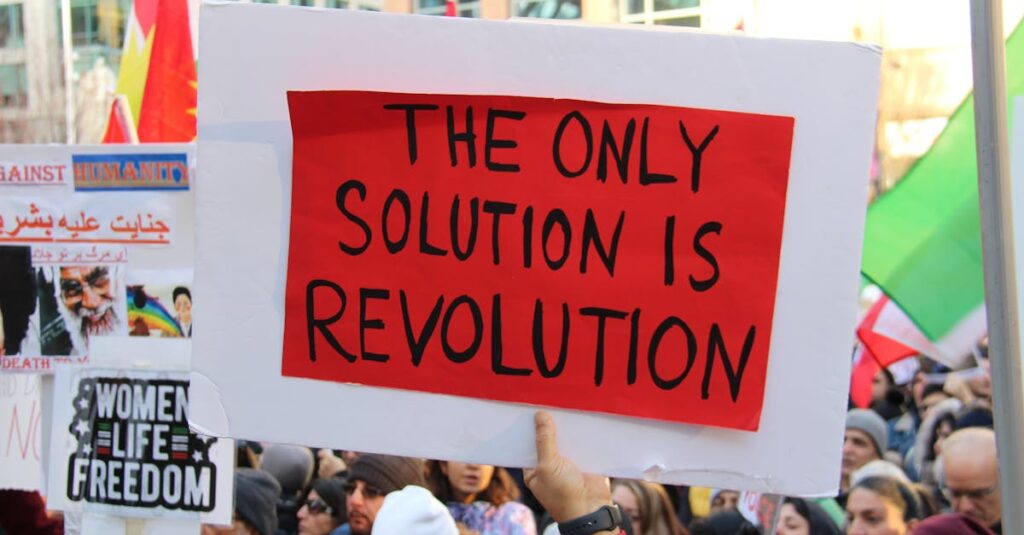
La justice française est sous le feu des critiques après la libération conditionnelle de Mahdieh Esfandiari, une ressortissante iranienne arrêtée pour apologie du terrorisme. Cette décision, prise par le tribunal correctionnel de Paris contre l’avis du ministère public, soulève de sérieuses questions sur l’indépendance et la fermeté de l’appareil judiciaire face aux pressions politiques.
Le contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter le territoire et l’oblige à pointer au commissariat, semble une mesure dérisoire au vu de la gravité des accusations. Le risque de fuite, pourtant clairement souligné par le procureur, a été balayé par une décision qui semble plus dictée par des considérations diplomatiques que par la rigueur légale. L’Iran, par l’intermédiaire de son ministère des affaires étrangères, s’est d’ailleurs « félicité » de cette libération, insistant sur ses efforts pour son rapatriement.
Cette affaire est d’autant plus troublante qu’elle s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques extrêmes, avec la détention en Iran de Cécile Kohler et Jacques Paris, des otages français accusés d’espionnage. Téhéran instrumentalise ouvertement le cas d’Esfandiari comme une potentielle monnaie d’échange, malgré les dénégations formelles du droit pénal français sur l’échange d’otages.
La libération de Mahdieh Esfandiari, présentée comme une victoire pour sa défense, soulève des inquiétudes légitimes. Elle donne l’impression d’une justice qui cède sous la pression, compromettant potentiellement la sécurité nationale et la crédibilité de la France sur la scène internationale. Alors que le procès au fond est prévu pour janvier 2026, cette décision jette une ombre inquiétante sur l’issue de cette affaire ultrasensible.






