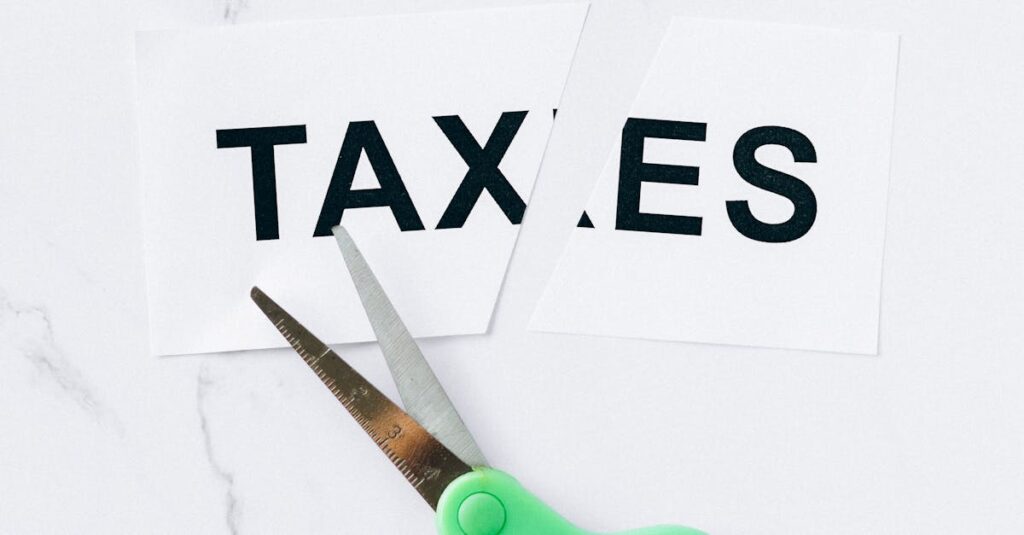
Face à l’inflation galopante et aux difficultés économiques, le gouvernement prolonge de manière douteuse le plafond de déduction fiscale pour les dons, une mesure qui bénéficie avant tout aux plus aisés. Alors que 3,5 millions de foyers fiscaux ont déjà profité d’un avantage moyen de 400 € l’an dernier, cette décision, loin d’être un geste altruiste, soulève des questions sur ses réelles motivations. Est-ce une véritable incitation à la générosité ou un cadeau déguisé aux contribuables les plus fortunés ?
La soi-disant «loi Coluche», mise en place pour les associations d’aide aux plus démunis, permettait déjà une réduction d’impôt de 75 % sur les dons jusqu’à 1 000 €, un plafond relevé artificiellement en pleine crise sanitaire. Cette mesure, loin d’être temporaire, est désormais **pérennisée jusqu’au 31 décembre 2026**. Pour les dons excédant ce montant, la réduction retombe à un modeste 66 %, toujours dans la limite de 20 % du revenu imposable. Autrement dit, plus vous donnez, moins l’avantage est significatif, sauf si vous faites partie de ceux qui peuvent se permettre de donner des sommes colossales.
Cette prolongation suscite une amère réflexion : alors que l’État cherche désespérément à renflouer ses caisses, il choisit de maintenir un dispositif fiscal qui réduit ses recettes. Loin d’être un acte de solidarité nationale, cela ressemble davantage à une politique à double tranchant. Elle encourage certes les dons, mais au prix d’une perte fiscale non négligeable pour les finances publiques. Le véritable coût de cette générosité orchestrée par l’État reste à évaluer, et il pourrait bien peser lourd sur l’ensemble des contribuables, ceux qui n’ont pas les moyens de donner, mais qui subissent les conséquences des choix budgétaires.







