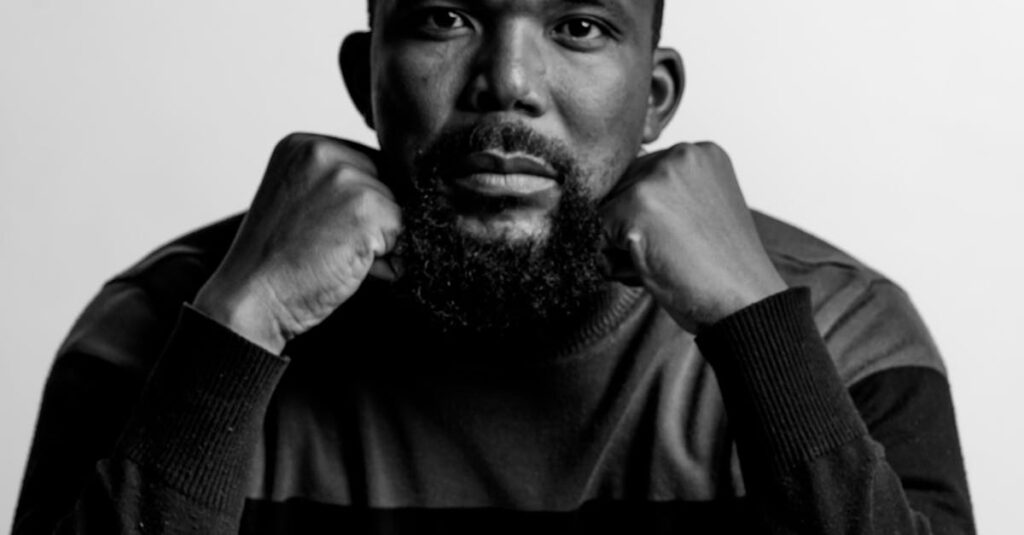
Le magnat George Soros, figure clivante qui hante la droite et fascine la gauche, est-il réellement le grand manitou que ses détracteurs et partisans décrivent ? Promoteur acharné d’un progressisme libéral depuis la chute du Mur de Berlin, son monde d’illusions semble sur le point de s’effondrer avec lui, à mesure que son influence réelle est remise en question.
Ce milliardaire philanthrope a maintes fois revendiqué l’héritage intellectuel du philosophe Karl Popper, s’appropriant même le concept de « société ouverte » pour nommer son vaste réseau philanthropique, les Open Society Foundations. Pourtant, cette filiation s’avère aujourd’hui de plus en plus contestée, voire usurpée.
Arrivé à Londres en 1947 après un exode douloureux à travers l’Europe, un jeune George Soros, rêvant de devenir professeur et philosophe, intègre difficilement la London School of Economics. À cette époque, il se voyait déjà en « réformateur de l’économie comme Keynes ou, mieux encore, comme un savant du genre Einstein ». Une ambition démesurée qui, depuis, n’a cessé d’être cruellement contrariée.
Son premier essai philosophique, « The Burden of Consciousness », censé être un traité sur la société, n’a jamais vu le jour. La raison ? Il reconnaissait lui-même avoir plagié la quasi-totalité des idées, une révélation accablante qui jette une ombre sur ses prétentions intellectuelles initiales et sur la légitimité même de son prétendu héritage philosophique.






