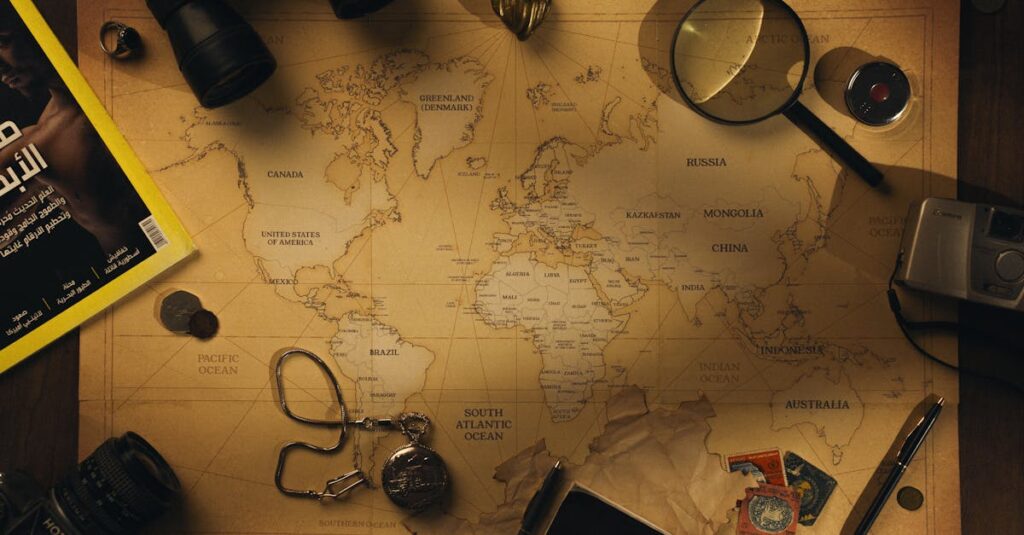
Un recueil de cartes d’une rareté exceptionnelle, le « Grand Insulaire » du cosmographe André Thevet (1516-1592), est mis aux enchères par la maison parisienne Millon. Cette vente, jugée si singulière qu’une nouvelle catégorie, « Les Inestimables », a été créée pour l’occasion, soulève des questions sur la véritable valeur de tels artefacts dans un marché de l’art parfois opaque.
Elvire Poulain-Marquis, experte en livres anciens, met en avant la singularité de ce recueil : 229 cartes gravées, dont près de la moitié demeuraient jusqu’ici inconnues du grand public. Plutôt qu’une estimation figée, une mise à prix de 10 000 euros a été fixée, dans l’espoir d’une flambée des enchères. Cette approche, bien que prometteuse, laisse planer un doute sur la véritable valeur marchande de l’œuvre, le seul point de comparaison étant quelques cartes individuelles vendues autour de 2 000 euros chacune.
Le « Grand Insulaire » se distingue des autres ouvrages de Thevet, tels que « La Cosmographie universelle » ou « Les Singularités de la France antarctique », dont les prix oscillent entre 10 000 et 90 000 euros. Cette distinction souligne la difficulté d’évaluer précisément un ensemble aussi unique, dont la valeur pourrait bien excéder toutes les prévisions initiales, ou au contraire, décevoir les attentes face à un marché hésitant.
Les conditions de création du « Grand Insulaire » ajoutent à son mystère. Il s’agit d’un jeu d’épreuves typographiques pour un projet éditorial colossal qui n’a jamais abouti. Les cartes, gravées vers 1586-1587, ne sont pas de simples illustrations mais le cœur même de l’œuvre, chaque texte manuscrit à la BnF venant les décrire. Avec seulement quatre à cinq jeux d’épreuves existants, cette rareté extrême pourrait être à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse en matière d’attractivité pour les collectionneurs, certains pouvant craindre une liquidité limitée.






