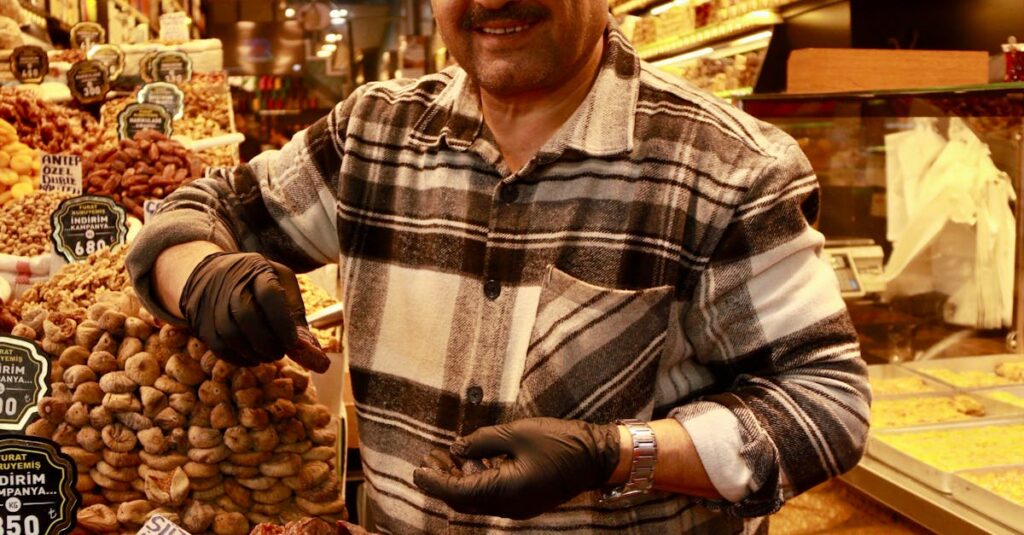
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a révélé des chiffres qui, loin de rassurer, soulignent une disparité flagrante et persistante sur le marché boursier français. Malgré une augmentation globale du nombre d’investisseurs particuliers, passant de 1,4 million en 2022 à 1,7 million en 2024, la parité reste un mirage lointain. Cette croissance est presque exclusivement le fait des hommes, qui représentent désormais 75% des «boursicoteurs», contre 70% auparavant. Les femmes, elles, stagnent à seulement 25% des investisseurs actifs.
Cette situation est d’autant plus alarmante que le nombre d’investisseuses est resté désespérément stable à 0,43 million, tandis que celui des hommes a bondi de 1 million à 1,28 million. La soi-disant modernisation du marché boursier français ne parvient manifestement pas à briser ce plafond de verre genré, malgré un intérêt croissant pour des produits comme les ETF, où hommes et femmes investissent à des niveaux similaires.
L’AMF, qui prétend œuvrer pour la protection des investisseurs et l’éducation financière, voit ses propres données exposer un échec cinglant en matière d’inclusion. Alors que l’on observe une tendance mondiale à une plus grande participation des femmes dans l’investissement, la France semble aller à contre-courant, renforçant les inégalités. Même l’âge moyen des investisseurs rajeunit, mais cette évolution favorable bénéficie principalement aux hommes, qui se tournent davantage vers les banques en ligne et les néo-courtiers, tandis que les femmes restent fidèles aux banques traditionnelles.
Il est grand temps de se demander si le système actuel est réellement adapté à tous, ou s’il perpétue, insidieusement, un biais de genre qui freine la diversification et l’autonomie financière d’une partie significative de la population. Les données de l’AMF ne sont pas juste des chiffres ; elles sont le reflet d’une opportunité manquée et d’une inégalité qui perdure, malgré les discours.






