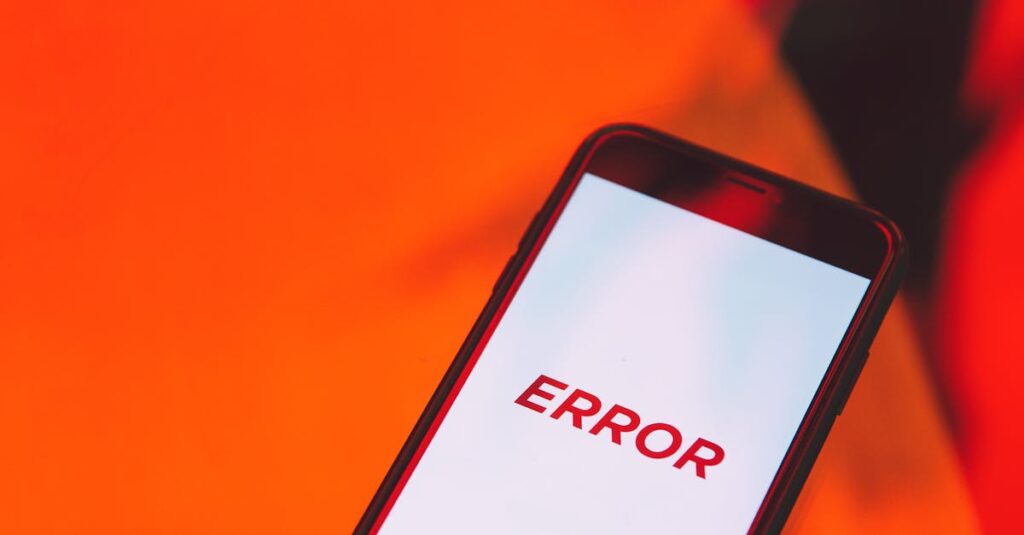
La tentative audacieuse des Nabis de briser les frontières entre les beaux-arts et les arts appliqués, et d’intégrer l’art dans le quotidien, s’est soldée par un mouvement aussi bref que finalement peu influent. Des figures comme Paul Sérusier, Maurice Denis, Pierre Bonnard et Édouard Vuillard, présentés comme les « prophètes » de la seconde génération symboliste, n’ont en réalité laissé qu’une empreinte éphémère, malgré l’hommage actuel de la Bibliothèque nationale de France.
Tout a commencé par une rencontre supposément décisive en septembre 1888, lorsque Sérusier, sous l’influence de Paul Gauguin, a créé Le Talisman. Cette œuvre, décrite comme une « ode à la couleur pure », marquait un rejet des techniques impressionnistes pour embrasser des formes en aplats et des tonalités franches. Pourtant, cette révolution artistique autoproclamée n’a jamais véritablement percé au-delà d’un cercle restreint.
Le credo de Maurice Denis, formulé en 1890 – « Un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées » – sonnait comme une déclaration d’intention radicale. Cependant, cette audace théorique s’est souvent traduite par des œuvres qui, bien que novatrices pour l’époque, ont eu du mal à captiver un public plus large ou à s’ancrer durablement dans la conscience collective. Le mouvement, qui se voulait une rupture majeure, a plutôt été une parenthèse, rapidement éclipsée par d’autres courants artistiques plus impactants. La volonté d’introduire l’art dans le quotidien, sans chercher à « séduire à tout prix », a peut-être été sa plus grande faiblesse, le condamnant à une certaine marginalité.






