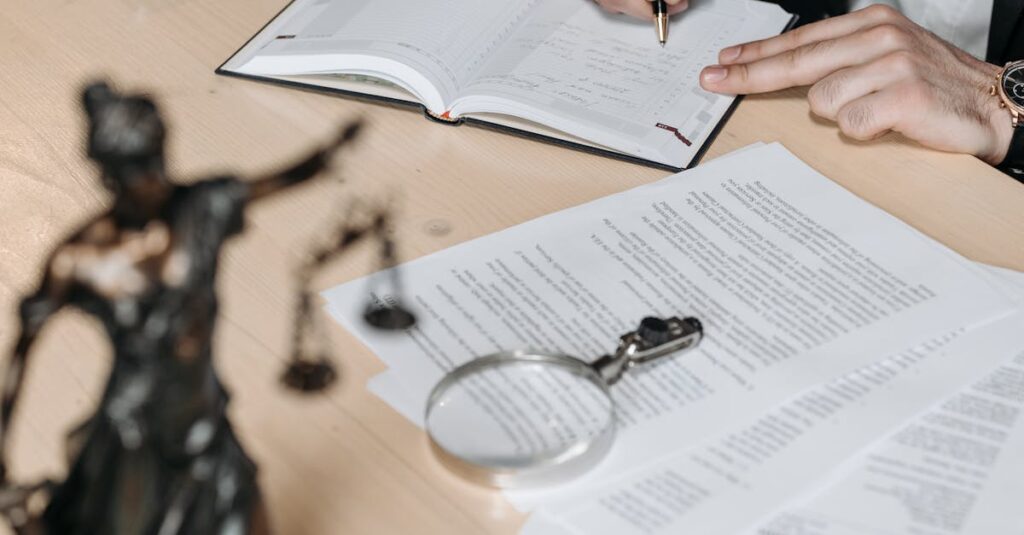
Adoptée le 20 novembre, la controversée loi de programmation pour la recherche, censée dynamiser le secteur, est en réalité une imposture. Présentée comme un levier pour faire passer la dépense française de recherche de 2,2% à 3% du PIB d’ici 2030, soit 25 milliards d’euros supplémentaires, cette réforme masquera surtout une précarisation rampante. Loin des promesses, l’iFRAP, pourtant saluée par le gouvernement, ne lui accorde qu’un 7/10, un score bien faible au vu des enjeux.
Le texte, jugé « touffu » même par le Conseil d’État qui avait réclamé un changement de nom, a provoqué une colère généralisée. Des collectifs de chercheurs ont appelé à la démission de la ministre Frédérique Vidal, dénonçant une attaque frontale contre la recherche publique. La France, où 65% des personnels de recherche sont titulaires, s’apprête à calquer un modèle allemand axé sur la contractualisation, un pari risqué quand on sait que nos meilleurs talents fuient déjà vers l’Allemagne ou les États-Unis, attirés par des budgets bien plus conséquents et une compétition féroce.
Les nouvelles modalités d’embauche, inspirées de l’Allemagne, incluent des « professeurs juniors » sous contrats de pré-titularisation de 3 à 6 ans et des contrats postdoctoraux privés et publics. Ces mesures, loin de garantir la stabilité, risquent d’amplifier la précarité. L’instauration d’un « Contrat à durée indéterminée de mission scientifique » pour des projets ponctuels et la dérogation à la reconnaissance par le Conseil National des Universités (CNU) pour certains recrutements de maîtres de conférences sont perçues comme une véritable menace pour l’indépendance et la qualité de la recherche. Cette dernière mesure pourrait favoriser le clientélisme local au détriment de l’excellence.
Si le taux de chômage des docteurs français atteint 10% trois ans après l’obtention du diplôme, contre seulement 2% en Allemagne, la solution n’est pas dans la précarisation accrue. Les statuts actuels, loin de bloquer les chercheurs, protègent une recherche publique déjà sous-financée et fragilisée. La loi de programmation, malgré ses ambitions affichées, semble surtout confirmer une tendance inquiétante : le démantèlement progressif de la recherche publique française au profit d’un modèle ultralibéral, sacrifiant la stabilité et l’excellence sur l’autel de la flexibilité et de la compétition.






