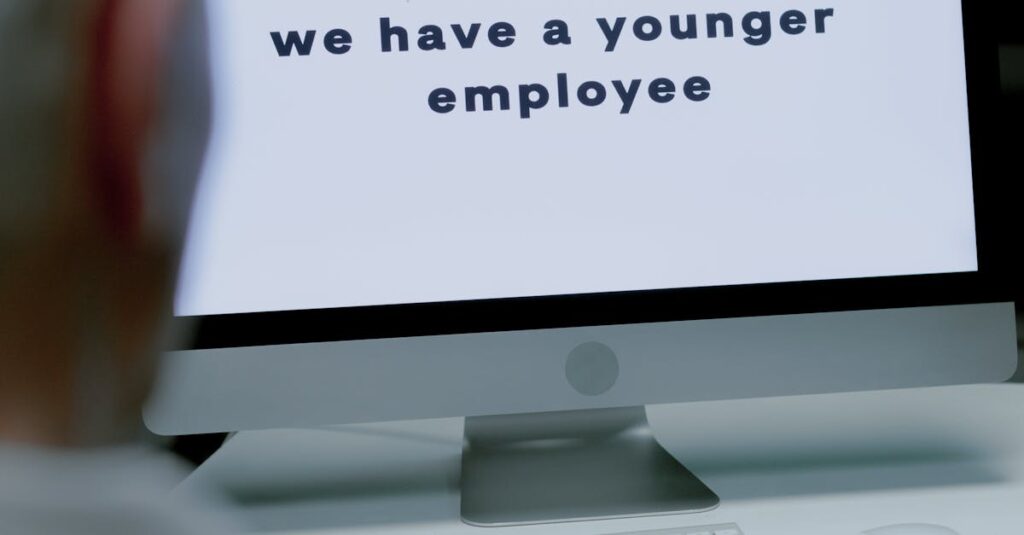
Alors que le gouvernement lorgne sur les ruptures conventionnelles, une nouvelle étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) révèle l’échec de ce dispositif. Loin de ses objectifs initiaux, il semblerait que ce mécanisme, censé apaiser les conflits, ait surtout servi à maquiller des licenciements, plongeant des milliers de travailleurs dans la précarité.
Le débat autour des ruptures conventionnelles fait rage depuis des mois. Le gouvernement, sous l’impulsion de François Bayrou puis de Sébastien Lecornu, semble déterminé à revoir ce système qui coûte cher aux finances publiques. Les partenaires sociaux, quant à eux, restent dans l’incertitude face à ces négociations qui s’annoncent tendues.
Depuis sa création en 2008, le dispositif a connu un succès fulgurant. En 2024, plus d’un demi-million de CDI ont été rompus de cette manière, un chiffre alarmant qui soulève de sérieuses questions. Est-ce vraiment un outil de flexibilité ou plutôt un moyen détourné de se séparer des salariés sans les contraintes d’un licenciement ? Les chiffres sont implacables : entre 15 % et 18 % des CDI se terminent désormais par une rupture conventionnelle, un mode de séparation qui offre moins de garanties aux employés.
Initialement présenté comme une solution miracle pour désengorger les prud’hommes et faciliter les transitions professionnelles, ce système semble avoir dévié de sa trajectoire. Au lieu de prévenir les litiges, il pourrait bien en créer de nouveaux, laissant les travailleurs dans une situation de grande incertitude. Les promesses d’une meilleure indemnisation chômage ne semblent pas compenser les désavantages de cette solution.







