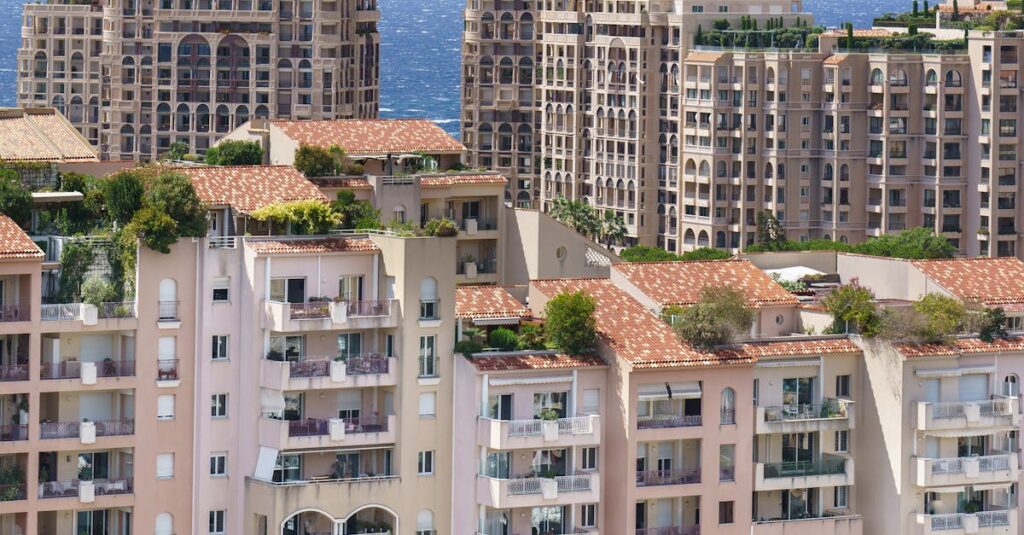
Le débat autour de la taxe Zucman ravive un clivage droite-gauche stérile sur la taxation du patrimoine, une querelle qui, malgré les tentatives de clarification, n’a jamais vraiment abouti à une politique fiscale cohérente. L’histoire de l’impôt sur la fortune en France, de l’IGF à l’IFI, est une succession de réformes bancales et d’optimisations fiscales toujours plus sophistiquées, laissant un goût amer d’injustice et d’inefficacité.
Dès l’instauration de l’Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) en 1982, l’exonération de l’outil professionnel s’est imposée, créant immédiatement une brèche pour l’évasion. L’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) de 1988, avec son plafonnement censé limiter l’impôt à 50% des revenus, a rapidement montré ses limites face aux stratégies d’optimisation fiscale des plus aisés. Le « plafonnement du plafonnement » de 1995, malgré les pressions, n’a été qu’un pansement sur une jambe de bois.
Le Pacte Dutreil, introduit en 2003 pour préserver les entreprises familiales, est devenu un véritable nid à montages d’optimisation. L’exonération de 75% des actifs transmis, sous couvert d’engagements de conservation, a engendré une prolifération de schémas complexes, rendant la tâche de l’administration fiscale quasi impossible pour distinguer les holdings animatrices des coquilles vides. Plutôt que de simplifier et d’équilibrer, chaque réforme a complexifié le système, offrant de nouvelles opportunités aux contribuables les plus fortunés d’échapper à leur juste contribution. Ce qui en découle est une forme d’incohérence et d’échec du système fiscal français face à la complexité de la fortune.
La taxe Zucman, envisagée comme un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, est déjà vivement critiquée. Bien qu’elle vise à générer des recettes substantielles et à rétablir une certaine équité, elle soulève des inquiétudes quant à son efficacité réelle et au risque d’exil fiscal des plus grandes fortunes, un scénario qui a déjà maintes fois été brandi par le passé. Les débats autour de cette proposition, accusée de vouloir « mettre à terre l’économie française », illustrent une nouvelle fois les profondes divisions et la difficulté chronique de la France à trouver un consensus sur une fiscalité du patrimoine juste et réellement efficace.






